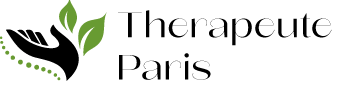Comprendre l’auto-compassion : une alliée souvent sous-estimée
Si je vous disais que la gentillesse envers vous-même peut être l’un des outils les plus puissants pour gérer vos émotions et reprendre le contrôle de votre vie, seriez-vous sceptique ? Pourtant, l’auto-compassion est loin d’être une douce utopie ou une pensée magique. C’est un véritable levier thérapeutique. Dans mon accompagnement des personnes anxieuses ou touchées par un faible amour propre, elle est devenue un de mes piliers d’intervention – et pour de bonnes raisons.
L’auto-compassion, telle que définie par la chercheuse Kristin Neff, c’est la capacité à se traiter avec la même bienveillance qu’on offrirait à un ami proche en difficulté. Cela implique de reconnaître ses souffrances, sans les amplifier ni les nier, tout en cultivant la compréhension et la bienveillance envers soi-même.
Contrairement à ce qu’on croit, se critiquer sans relâche n’est ni une preuve d’exigence élevée, ni un moteur de progrès. C’est souvent le carburant de l’anxiété, de la honte et de l’isolement émotionnel.
Pourquoi l’auto-compassion est une réponse pertinente à l’anxiété
L’anxiété est souvent nourrie par une avalanche de jugements intérieurs du type :
- « Je n’y arriverai jamais. »
- « Si j’étais plus organisé.e, je ne serais pas aussi stressé.e. »
- « Tout le monde gère mieux que moi. »
Ces pensées récurrentes activent le système limbique et notamment l’amygdale, qui déclenche les réactions de stress. L’auto-compassion, à l’inverse, active ce que l’on appelle le « système de soin » – c’est-à-dire un réseau neurologique qui favorise la sécurité intérieure, régule le cortisol (l’hormone du stress) et libère de l’ocytocine, l’hormone du lien et de la confiance.
Des études publiées dans Journal of Anxiety, Stress & Coping ont démontré que les personnes qui pratiquent l’auto-compassion ont tendance à ressentir moins d’anxiété sociale, à mieux faire face aux situations stressantes et à faire preuve d’un plus grand équilibre émotionnel.
D’un point de vue thérapeutique, cette approche évite aussi le piège de la dualité bien/mal : on reconnaît le trouble sans s’identifier à lui. On apprend ainsi à dire « je ressens de l’anxiété » plutôt que « je suis anxieux », ce qui change profondément la relation à la souffrance.
Renforcer l’estime de soi sans tomber dans le narcissisme
Contrairement à l’affirmation de soi excessive ou au discours de motivation souvent trop centré sur la performance, l’auto-compassion apporte une estime de soi durable. Pourquoi ? Parce qu’elle n’est pas conditionnée à la réussite.
Il ne s’agit pas de se dire chaque matin qu’on est « formidable » dans une logique de positivité toxique. Il s’agit plutôt d’adopter un regard compréhensif : « Ce que je traverse est difficile, et c’est humain d’en souffrir. Je fais de mon mieux. »
Ce changement de posture a un effet radical sur l’estime de soi. On ne s’aime pas parce qu’on réussit, on s’accepte même quand on échoue. L’estime se base alors sur notre valeur intrinsèque, pas sur la validation extérieure. C’est cette stabilité qui protège contre la dévalorisation et le doute existentiel.
L’auto-compassion en pratique thérapeutique
Les thérapeutes l’intègrent de plus en plus dans leurs protocoles. En thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT), en pleine conscience (MBSR/MBCT), ou en thérapies cognitives et comportementales, l’approche auto-compassionnée est précieuse.
Voici quelques pratiques simples que je propose souvent à mes accompagnés :
- Le journal d’auto-compassion : écrire tous les soirs une ou deux phrases comprenant reconnaissance de la douleur vécue, soi commun (« d’autres vivent cela aussi »), et bienveillance envers soi.
- Méditations guidées d’auto-bienveillance : axées sur l’envoi de pensées douces et de chaleur à soi-même.
- L’exercice de la chaise vide : se parler comme on parlerait à un ami en difficulté, à voix haute.
Ces outils ne remplacent pas une thérapie dans les cas sévères, mais ils peuvent initier un changement de regard puissant et durable.
Légalité et reconnaissance de l’approche en France
En France, si l’auto-compassion n’est pas encore explicitement décrite dans les textes de lois encadrant la pratique psychothérapeutique, elle est pourtant tout à fait compatible avec les recommandations actuelles. La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande notamment les thérapies basées sur la pleine conscience et la TCC pour de nombreux troubles mentaux, notamment l’anxiété (voir rapport HAS, 2020).
Dans le champ de la psychologie, l’auto-compassion est aujourd’hui un champ de recherche validé, notamment aux États-Unis et au Canada. Elle est également de plus en plus intégrée dans les formations professionnelles de psychologue clinicien, coach ou praticien en relation d’aide. La psychothérapie basée sur l’auto-compassion (Compassion-Focused Therapy, développée par Paul Gilbert), est mieux reconnue d’année en année pour son efficacité auprès de patients souffrant de honte ou de traumatismes profonds.
Reconnaître sa vulnérabilité comme force
Ce qui peut nous rendre plus humains n’est pas notre capacité à être toujours positif, mais celle à nous accueillir dans les moments les plus sombres. Quand on accepte notre vulnérabilité avec tendresse, on réduit l’isolement intérieur. Et ça, c’est un pas vers la guérison.
En tant que consultante, je vois quotidiennement combien la mise en place de cette bienveillance transforme la façon de vivre l’anxiété et les blessures de l’estime. Les petits rituels d’auto-compassion, bien intégrés dans le quotidien, deviennent des réflexes de survie émotionnelle durables. C’est un travail, évidemment. Mais un travail qui vaut chaque seconde investie.
Parce que la relation que vous entretenez avec vous-même est la plus longue de votre vie. Autant qu’elle soit pleine de douceur.
— Clarence
Je suis Clarence, je conseille les particuliers sur les sujets de santé et de bien-être. Je suis rédactrice du site www.therapeute-paris.frr depuis 2021